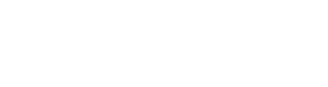Voilà une trentaine d’années qu’Arno Calleja poursuit sa trajectoire d’auteur explorant les marges, tant auprès des personnes qu’il a pu côtoyer lors de boulots et ateliers d’écriture que dans ses livres pensés pour « déborder le strict cadre de la page ». Lui qui aime faire vivre des personnages qui se racontent voire écrivent eux-mêmes, prête également le don de parole aux animaux, objets et éléments. Il revient, pour Flaix, sur son écriture et son métier, tout deux à la fois non conventionnels mais pourtant profondément ancrés dans le réel.
Si tu devais te présenter brièvement, dirais-tu que tu es écrivain, artiste, poète ? Les trois ?
Écrivain me plait bien, parce qu’il y a le mot « écriture » dans écrivain. Je ne me considère ni romancier, ni poète, ni dramaturge parce que ce sont des disciplines qui ont leur propre histoire, même si ça m’arrive d’écrire pour le théâtre. Effectivement, en ce qui me concerne, c’est l’écriture au sens physique, plastique, sonore… C’est avec ça que je fabrique des choses.
Comment es-tu arrivé à l’écriture ? Es-tu parvenu à en vivre rapidement ?
Après une formation en philosophie à l’université d’Aix-en-Provence que j’ai assez vite interrompu, j’ai retrouvé Marseille. J’avais la vingtaine et cette ville où j’ai grandi est redevenue ma base, mon ancrage. C’est là où j’ai commencé à écrire vraiment, à faire des lectures, des premières collaborations. J’y ai fait beaucoup de rencontres et j’ai évolué naturellement dans la scène poétique des années 2000-2020, notamment en fondant une revue avec Laura Vazquez et en travaillant avec Liliane Giraudon qui est une figure importante de la poésie expérimentale. Pour vivre, j’ai fait un tas de boulots, mais qui, par hasard et par chance, étaient presque toujours en lien avec l’écriture. Par exemple, durant plusieurs années j’étais rédacteur de « récits de vie » pour un centre d’insertion professionnelle. Cela consistait à rédiger des biographies de personnes en rupture de banc complète afin de leur aider à construire un CV dans l’objectif de retrouver un emploi. J’ai beaucoup travaillé dans des lycées professionnels avec des jeunes issus de quartiers populaires. J’ai aussi mené des projets d’écriture à la prison des Baumettes.
Ces expériences ont-elles influencé ton travail ?
Oui, il y a forcément un lien avec mes livres. Le fait de voir et d’entendre des trajectoires de vie brisées, de suivre des parcours de personnes en marge, a nourri mon écriture.
Depuis quelques années je travaille aussi en tant que dramaturge pour la compagnie ‘’ Le théâtre de Ajmer’’ et suis co-scénariste pour l’adaptation de l’un de mes livres en long-métrage par Georgia Azoulay. Je suis très heureux de la dimension collective de ces expériences.
Tu oscilles souvent entre poésie et prose poétique. Les rares textes estampillés romans restent toujours affranchis d’un certain nombre de conventions d’écritures. On est loin du roman classique pur et dur.
Oui, c’est vrai. Je crois que je serais incapable de faire un roman traditionnel à l’imparfait-passé simple, avec toute l’organisation classique et scolaire qui a encore majoritairement lieu actuellement. Dans la majorité des productions romanesques, il y a du personnage, de la narration type téléfilm, de la chronologie, etc. Moi effectivement ce n’est pas du tout ni mon goût, ni ma manière d’appréhender le récit, la narration et l’écriture. Dans mes textes, j’aime que mes personnages parlent et écrivent depuis eux-mêmes, j’aime me mettre en position d’écoute et de secrétaire par rapport à eux.
On retrouve aussi une écriture très spontanée et orale. Tes textes semblent écrits comme s’ils étaient absolument destinés à la lecture à voix haute.
Oui et cela a un peu à voir avec mon trajet d’écrivain. Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai commencé à faire exister mes textes en les lisant dans différents lieux : des petits festivals, des théâtres, des bars, mille endroits. En les oralisant, en les disant. Cette dimension du personnage qui parle — ou même du personnage qui écrit — et donc d’une écriture qui vient s’embarquer dans des dimensions très rythmiques, très musicales, très « chant » au sens de la poésie première, ça, c’est sûr que ça a toujours été là. Je fabrique des livres, mais ce qui s’y passe a quand même pour velléité, pour désir, d’en sortir et d’être dit, d’être lu, d’être entendu. Il faut toujours que ça sorte et que ça devienne une forme de chanson, de chant. Faut quand même que ça déborde un peu le strict cadre de la page.
Tu considères l’écriture comme quelque chose de presque indépendant de toi ?
Oui. C’est assez intérieur d’abord. L’écriture c’est quelque chose qui agit un peu, qui remue en soi, qui s’impose. Mais d’une autre manière aussi, je vois un peu l’écriture comme un élément, comme quelque chose qui existe en dehors de nous, comme de la pluie, comme du temps,… comme un élément naturel, quelque chose qui était là avant que les hommes et les femmes se mettent à parler. Je le sens un peu comme ça, dans une ambivalence entre quelque chose d’intérieur et d’une chose toute extérieure, un pur dehors qui vient nous visiter quand il veut, et qu’on ne maîtrise absolument pas.
Comment se passe l’élaboration d’un texte ?
Par exemple, pour Un Titre Simple, c’est vraiment des textes que j’écrivais le matin au réveil de manière un peu brûlante, directe et pulsionnelle, inconsciente. Et pour La Mesure de la Joie en Centimètres, c’était plus lié à des pérégrinations dans Marseille, cette ville où je suis né, j’ai grandi, j’ai vécu. C’est toujours des situations soit d’écriture, soit de ma biographie, de lieux que je connais, de gens que j’ai pu croiser… Ça part toujours de choses vivantes, incandescentes et incompréhensibles.
Est-ce que ton lieu de résidence à Aix, tes origines marseillaises, ou le Sud plus globalement, influencent ton écriture ?
Même si je n’écris pas toujours des textes biographiques, j’ai toujours des personnages, des choses qui se baladent quand même assez loin dans mon imaginaire. Mais il y a quand même Marseille qui est régulièrement présente. Cette ville, sa crudité, sa violence, son comique, sa pauvreté, sa réalité, tout cela transpire dans mes textes, c’est sûr. Et puis y’a un autre lieu qui est important pour moi, c’est l’Asie, et notamment Taiwan qui m’a inspiré La Rivière Draguée. Là aussi, c’est lié au lieu, à Taipei, la capitale, et à la rivière qui traverse cette ville. Il y a des histoires liées à cette rivière. Donc effectivement, les lieux agissent pas mal dans mes textes. Les lieux, les lumières et les histoires qui peuvent se tisser dans une ville, que ce soit Marseille ou Taïwan. Quant à Aix, j’y suis plutôt de manière transitoire et y vivre n’a semble t-il pour le moment pas eu d’impact sur mon imaginaire.
D’ailleurs, dans La Rivière Draguée, tu donnes carrément la parole au lieu, à la rivière.
J’ai utilisé, sans connaître le mot que j’ai découvert après, un principe, une forme de rhétorique qui s’appelle la prosopopée. C’est le fait de faire parler un élément ou un objet. Dans La Rivière Draguée, la rivière elle-même prend la parole, ainsi qu’une autre personne qui n’est pas humaine. Les lieux, les animaux, les morts, ont, dans mes textes, absolument droit à la parole comme les vivants. Je ne fais pas de distinguo entre ces régimes-là, les êtres les non-êtres. Les humains et les non-humains ont droit à l’écriture et à la parole aussi.
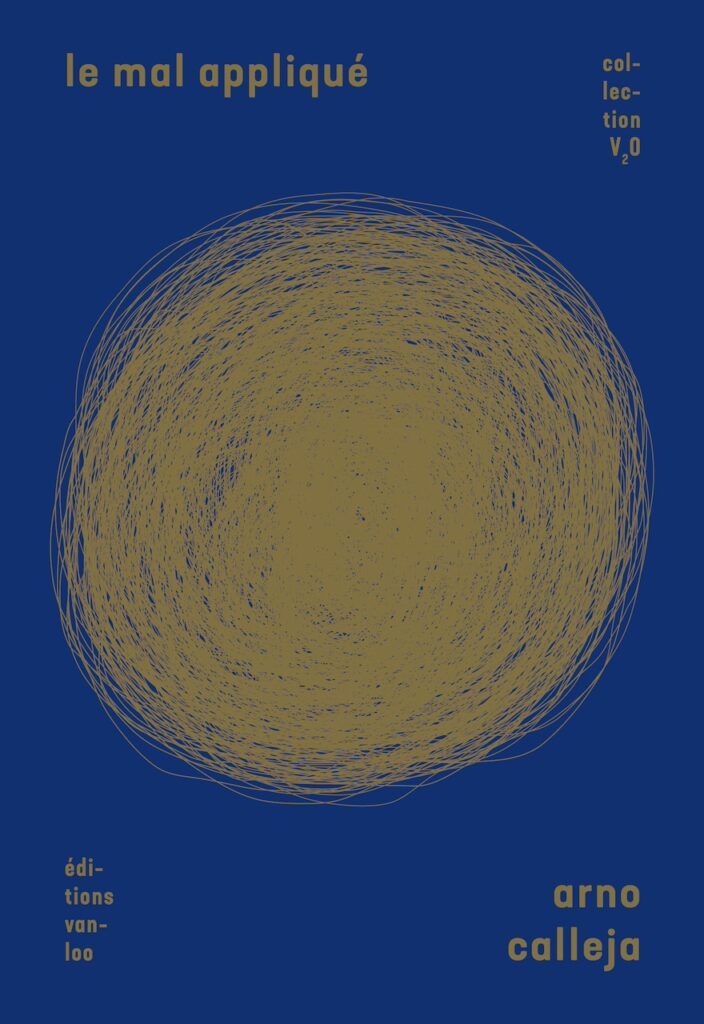
Et à propos du Mal Appliqué ? Qui est sorti à l’automne…
C’est un type qui cesse de travailler, qui emménage dans sa voiture parce qu’il n’a plus de piaule. Et dans sa voiture il décide d’écrire parce qu’il a toujours vaguement rêvé d’écrire son journal. Donc il est dans sa voiture, il fume beaucoup de shit et il attend. Il déambule dans Marseille en attendant de noter des phénomènes de grande importance parce qu’il est sûr qu’il est en train de se passer quelque chose. Donc c’est son journal, dans Marseille, dans sa voiture. Il commence par écrire dans un cahier, et puis après à Marseille on ne trouve plus de cahiers parce que tout s’effondre. Il continue son journal en écrivant sur son smartphone, et son smartphone meurt. Ill finit d’écrire son texte sur un vieux Nokia sur lequel il manque des touches. Je me suis amusé à tester différents types d’écritures : un narrateur qui écrit sur ses genoux, dans sa voiture, sur un cahier, ça produit une certaine phrase, une certaine syntaxe. Puis s’il écrit dans cette voiture, mais sur un petit téléphone, avec ses pouces, ça produit une autre écriture, une autre ponctuation. Je me suis vraiment amusé à mettre en scène l’écriture elle-même au travers d’un personnage. C’est des motifs que j’aime bien : des gens qui vivent et disent ce qu’ils sont en train de vivre.
Quels sont tes modèles littéraires ? Ceux qui ont eu la plus grande influence sur toi en tant que lecteur ?
Quand j’étais plus jeune, bizarrement, j’aimais beaucoup les proses très classiques de la philosophie, de Descartes, de Spinoza, des Latins. Je trouvais ça vraiment extraordinaire et nourrissant. Et puis il y a des textes qui ont été importants pour moi quand j’avais 20 ans et que je découvrais la poésie : des textes d’auteurs de l’art brut. Et puis la poésie du XXe siècle, Valère Novarina, qui d’autre ? Il y en a mille ! Le roman, j’ai découvert ça plus tard, par Faulkner notamment, Beckett aussi. Y’a cette littérature américaine-là qui est aussi prise dans des grandes narrations, des grands personnages, des grandes situations, mais toujours des sortes de flux de pensée, des flux monologiques — comme chez Faulkner — et effectivement, je suis quand même assez proche de ça d’une certaine manière. Avec mes petits moyens, mais c’est des choses auxquelles je pense souvent.
Un conseil à donner à un jeune auteur ou quelqu’un qui souhaiterait se lancer dans l’écriture ?
Le plus dur c’est d’écrire comme si personne ne te lirait jamais, c’est-à-dire d’aller tout de suite au bout de la liberté folle et totale que permet l’écriture. C’est presque un anti-conseil parce qu’un jeune ou une jeune autrice au début doit essayer de savoir ce qu’il a à dire, avec quels moyens. Il doit trouver des lecteurs, il doit trouver des gens pour lui faire des retours. C’est sûr. Il y a cette phrase que j’ai vue sur les réseaux récemment : « danse comme si personne ne te regardait ». Tu vas dans une foule et tu danses comme un fou, comme si tu étais tout seul dans ta salle de bain. Mon conseil ce serait de faire pareil, avec l’écriture : écrire comme si personne ne te lirait jamais, dans ta liberté folle et ton goût propre.

Propos recueillis par Léa Stinellis et Léa Cesari
Retrouvez un extrait du Mal appliqué dans Flaix magazine n°2 (novembre-décembre 2025).